Bien que la présence de monuments publics dans les habitats des trois derniers siècles de l'âge du Fer soit probablement liée à l'accentuation de la "méditerranéisation" du sud de la Gaule, ces monuments sont bien moins nombreux ici que dans les civilisations classiques. Une enquête portant sur l'ensemble de la Celtique méditerranéenne  n'en avait dénombré en 1992 qu'une dizaine. n'en avait dénombré en 1992 qu'une dizaine.
Ces monuments, qui au IIe âge du Fer se situent toujours en contexte urbain ou villageois (alors qu'au Ier âge du Fer il en est d'isolés), présentent, au-delà de certains caractères communs, des morphologies diverses. Il peut s'agir de grandes salles hypostyles munies de piliers intérieurs sur l'axe médian, comme à Glanum (IIe s.), Saint-Blaise (IIe s.), Vitrolles (Le Griffon, IIIe s.) ou Ensérune (Ier s.); ou bien de piliers en façade, comme à Roquepertuse (IIIe s.) ou à Nîmes (Villa Roma, Ier s.); ou bien de piliers à la fois à l'intérieur et en façade, comme à Entremont (IIe s.); ou d'une grande salle munie d'une banquette périphérique, comme à Mouriès (Les Caisses) (IIe-Ier s.) ou à Roque de Viou (Ier s.); ou bien encore de salles entourées d'une sorte de péribole, comme à Nages et Roque de Viou (Ier s.).
À Roquepertuse et à Entremont, on exposait sous ces portiques des têtes d'ennemis ramenées du combat, fixées sur des piliers ou des linteaux, et l'on abritait peut-être des statues de guerriers accroupis, encore que ces dernières aient toujours été mises au jour à l'extérieur. Une statue d'accroupi
 et un linteau
et un linteau
 à encoche céphaloïde ont été aussi retrouvés à Nîmes près du monument de Villa Roma, mais en réemploi dans des murs, ce qui implique un état antérieur.
à encoche céphaloïde ont été aussi retrouvés à Nîmes près du monument de Villa Roma, mais en réemploi dans des murs, ce qui implique un état antérieur.
Ces découvertes ont conduit à interpréter ces édifices hypostyles comme des hérôa, lieux de commémoration des héros de la cité et de valorisation des valeurs guerrières dont la vocation religieuse, d'abord affirmée, a été récemment mise en doute au profit d'une vision plus sociale et plus politique du phénomène.
Mais dans la plupart des cas cités ci-dessus, les salles en question sont retrouvées quasiment vides et n'offrent dans leur mobilier ou leur architecture aucune clef permettant de déterminer leur fonction : que nous disent en effet sur les pratiques associées, sur les rituels perpétrés, une banquette ici, quelques fosses là creusées dans le sol? Peut-on attribuer un même usage à tous ces édifices qui n'ont en commun que le fait de n'être pas des habitations? Faut-il privilégier l'aspect religieux, comme le font souvent les archéologues devant des vestiges qu'ils ne comprennent pas? Ou bien l'aspect civil, en imaginant –sans forcément leur coller un nom– des lieux de réunion, de mémoire ou de décision? On le voit, cette problématique reste largement ouverte.
Pour l'époque romaine, on retient ici principalement quelques exemples lattois, parmi lesquels un petit fanum et la schola découverte dans la ville ancienne au bord de la rue principale 100. |

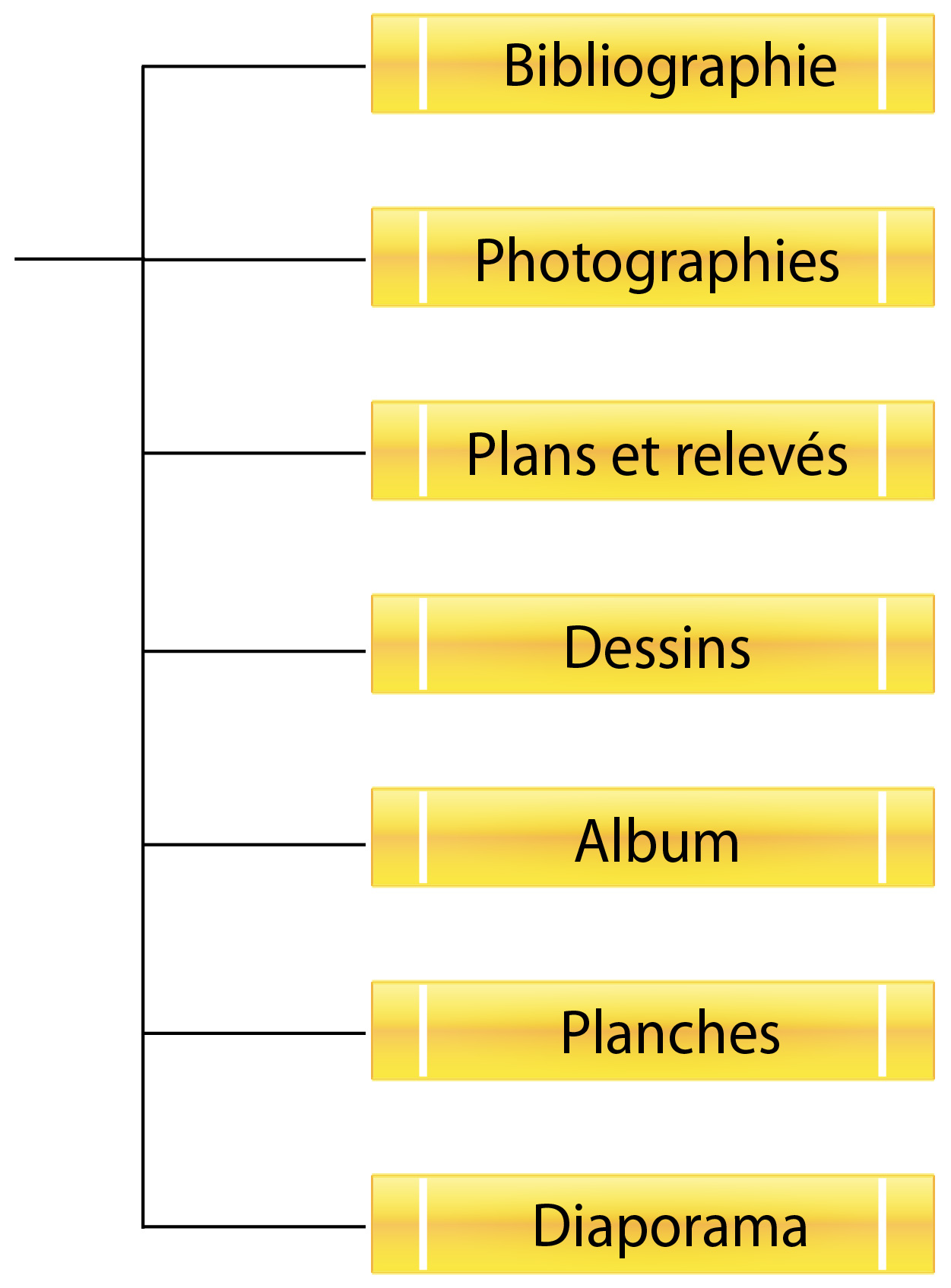
|